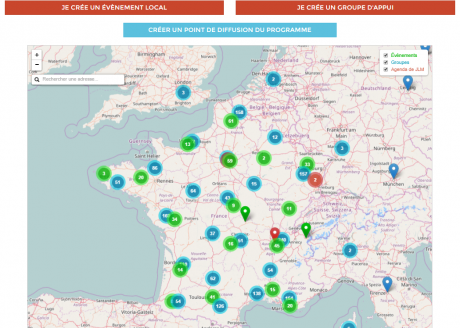Le Danemark perce le secret de la consommation d’eau sans énergie
En termes d’écologie, les pays scandinaves sont en général à la pointe, et la gestion de l’association eau-énergie ne fait pas exception à cette règle.
« L’histoire de la gestion de l’eau à la danoise est un vrai conte de fées », assure Katrine Rafn, directrice des ressources hydrauliques au ministère danois de l’Environnement. Ces trente dernières années, le Danemark a « réussi à percer le secret » de l’association entre croissance économique et gestion efficace de l’eau.
« Le secret est un mélange savant de développement de politiques, de réglementation intelligente et d’innovation technique » impliquant une coopération entre les autorités publiques, le secteur privé et les gestionnaires hydrauliques, a-t-elle expliqué lors d’un événementEurActiv.
« La gestion efficace de l’eau repose sur une gestion de tout le cycle hydraulique », a-t-elle continué. « Cela concerne la consommation, l’extraction et la distribution, mais aussi le transport des eaux usées et leur traitement. Cela concerne absolument tout. »
L’industrie utilise beaucoup d’eau, l’industrie de l’eau aussi
La production d’énergie peut être très gourmande en eau. L’eau est principalement utilisée pour refroidir les centrales thermiques et nucléaires, mais aussi dans la fabrication de biocarburants et le nettoyage des panneaux solaires dans les centrales photovoltaïques.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a récemment mis un coup de projecteur sur l’association eau-énergie. Dans son dernier rapport mondial, publié le 16 novembre, l’association estime que presque toutes les faiblesses du système énergétique mondial, qu’elles soient liées à l’accès à l’énergie, à la sécurité énergétique ou à la lutte contre le changement climatique, pourraient être exacerbées par une modification de l’accès à l’eau.
« L’industrie de l’eau utilise beaucoup d’énergie, environ 4 % de l’électricité produite sur la planète », souligne Mads Warming, directeur de l’eau et des eaux usées chez Danfoss, une entreprise d’ingénierie danoise, qui a soutenu l’événement organisé en novembre par EurActiv. Ce chiffre devrait cependant doubler d’ici 2040 si rien n’est fait pour le limiter, selon l’AIE.
La réussite danoise : passer au coût zéro
« Ce que nous avons montré, c’est qu’il est possible de faire passer ce chiffre à zéro », conclut Mads Warming.
Dès les années 1970, le Danemark a réalisé qu’il fallait rendre la gestion de l’eau moins gourmande en énergie. À l’époque, il y avait dans le pays un excès de prélèvement d’eau, les rivières et zones côtières étaient polluées aux eaux usées et la consommation d’eau était trop grande et inefficace, assure la représentante officielle.
Depuis, le pays a réussi à réduire l’utilisation d’eau à une moyenne de 107 litres par personne par jour. À Copenhague, la consommation a été réduite de 42 % depuis 1985.
Une tendance partagée par l’industrie, souligne Katrine Rafn. Au niveau industriel, les fuites ont été limitées à 8 % de moyenne dans tout le pays. Les nappes phréatiques desquelles l’eau est extraite ont été extensivement cartographiées, afin de permettre une « prise de contrôle sur les ressources ». « Nous savons où elles sont et combien elles sont, nous pouvons donc les protéger de la pollution et de la surexploitation », a expliqué la représentante du ministère.
Preuve du changement d’attitude, les eaux usées sont d’ailleurs aujourd’hui appelées « ressources hydrauliques ».
Pourquoi le reste du monde ne copie-t-il pas la solution danoise ?
Résultat : le secteur de l’eau n’utilise plus au Danemark que 1,8 % de l’électricité consommée dans le pays. Et les technologies permettant de rendre le secteur neutre sont là, insiste la Danoise. La ville d’Aarhus, par exemple, entend rendre son cycle hydrologique énergétiquement neutre d’ici 2020, a annoncé Lars Schröder, PDG d’Aarhus Water. D’autres villes danoises lui ont emboîté le pas.
Alors pourquoi le reste du monde ne copie pas la solution danoise ? « On pense généralement que tout est cher au Danemark, y compris l’électricité », a expliqué Mads Warming, de Danfoss, mais les prix de l’électricité y sont moins élevés qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne, et équivalent à la moitié des prix italiens, un peu comme au Brésil ou en Chine.
Tarifer l’eau avec un recouvrement des coûts complet
« Cela semble trop beau pour être vrai ? Eh bien ça peut être fait », confirme Katerine Rafn, qui estime que le moteur de la réussite danoise a été une tarification de l’eau avec un recouvrement de coûts complet. « Les prix de l’eau incluent tout le cycle hydrologique, y compris l’investissement dans les nouvelles technologies », a-t-elle poursuivi, indiquant que Copenhague avait introduit une pénalité fiscale pour pousser les infrastructures de gestion de l’eau à éviter de dépasser les 10% de fuite.
La législation européenne n’est toujours pas appliquée
Pavel Misiga, qui dirige l’unité sur l’eau potable du département environnement de la Commission, juge que les secteurs de l’eau et de l’énergie sont confrontés aux « mêmes problèmes » et aux « mêmes failles des marchés ». Il rappelle que les législateurs européens n’ont pas ignoré le secteur de l’eau, mentionnant la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, adoptée en 1991, et la directive-cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, de 2000, qui a introduit la tarification de l’eau comme outil politique au niveau européen.
Pourtant, « cette législation n’est toujours pas appliquée en Europe », a regretté le fonctionnaire, qui tient notamment pour responsable un manque d’investissement. Selon la Banque européenne d’investissement (BEI), il faudrait environ 90 milliards d’euros d’investissement pour que les mesures soient concrétisées. Ce manque d’investissement se traduit par la négligence des objectifs environnementaux et par des services aux citoyens laissant à désirer, a-t-il estimé.
L’eau « crée aussi des dettes publiques énormes »
L’eau « crée aussi des dettes publiques énormes », a poursuivi Pavel Misiga, qui indique que ces chiffres ne figurent cependant pas dans les comptes nationaux, « mais à l’avenir, ce problème doit être résolu ».
Katerine Rafn se montre plus optimiste quant au rôle potentiel de l’UE et appelle la Commission à mettre en place des objectifs ambitieux.
« Pourquoi ne pas instaurer une loi européenne commune fixant un maximum de 10% de perte pour le secteur de l’eau ? Je pense que c’est faisable, la technologie existe et nous avons de nombreux exemples de sa mise en pratique », a-t-elle plaidé.
Le Danemark teste actuellement une autre idée, de nouveaux indicateurs environnementaux complétant les marqueurs utilisés pour l’efficacité énergétique du secteur. « Je me demande donc pourquoi nous ne pourrions pas mettre cela en pratique au niveau européen, afin de pouvoir comparer les efforts des pays et que ceux-ci apprennent les uns des autres », précise la représentante danoise.
La Chine a déjà appris de l’expérience danoise et introduit un objectif limitant les pertes à 10 %, or « si les Chinois peuvent le faire, nous le pouvons aussi », a-t-elle fait remarquer.
>Lire : Des doutes sur la directive-cadre sur l’eau
Révision de la directive-cadre sur l’eau
Pour Pavel Misiga, la révision de la directive-cadre sur l’eau en 2019 est l’occasion de considérer de nouveaux objectifs ou de nouvelles normes européennes. Il a néanmoins prévenu qu’il y aurait des « obstacles politiques » pour atteindre un accord à l’échelle européenne, sur la mise en avant d’« outils plus souples » comme un meilleur accès aux financements et sur l’élimination des risques d’investissements dans les technologies de gestion de l’eau.
« Le problème avec une norme ou un objectif universels, c’est qu’il y a des différences énormes en Europe », a souligné Pavel Misiga, qui a comparé des pays comme l’Allemagne et le Danemark où les pertes d’eau représentent seulement 6% à des villes en Roumanie où les pertes peuvent atteindre 40%.
« Nous risquons donc de ne pas réussir à nous mettre d’accord », a-t-il prévenu, soutenant une approche plus souple. « Et pour cela, nous n’avons pas besoin d’attendre une nouvelle loi », a-t-il déclaré, encourageant ainsi les villes à se servir du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) – le fameux plan Juncker – pour investir dans des projets liés à l’eau et à l’énergie.
Quoi qu’il en soit, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a souligné la nécessité d’aborder le lien entre eau et énergie, rappelant que le coût de l’inaction finirait par monter en flèche.
« Nous n’avons pas le temps d’attendre », a déclaré Kamel Ben Naceur, directeur des technologies et des perspectives à l’AIE :
« Si nous ne le faisons pas maintenant, le système pour le faire après-coup sera beaucoup plus couteux. Et si nous ne le faisons pas du tout, le coût d’adaptation sera astronomique. »
Tout en admettant que répliquer le modèle danois « serait quelque peu complexe » à cause des différences nationales, Kamel Ben Naceur a mis l’accent sur les énormes bénéfices économiques découlant de la collecte et du traitement des eaux usées dans les villes d’Europe.
___
>CONTEXTE
La directive-cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau appelait les États membres à créer des encouragements concrets pour une consommation plus efficace de l’eau d’ici 2010. Il est toutefois difficile de déterminer si cela a eu un impact réel sur les politiques nationales, selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
La consommation d’eau par secteur varie entre les différents pays de l’Union européenne. L’agriculture est le secteur le plus gourmand en eau potable dans les régions les plus sèches, remplacé par les secteurs de l’énergie et de l’industrie dans les États plus humides.
Dans l’ensemble, les foyers, entreprises, hôpitaux et bureaux représentent 20% de la consommation totale, selon un rapport de 2012 de l’AEE. Les chasses d’eau à elles seules correspondent à près d’un tiers de ce chiffre, mais les fuites occasionnées par la vétusté des installations et tuyaux engendrent également des pertes importantes.
Les appels à davantage d’efficacité dans ce domaine se multiplient, et pas seulement au niveau législatif. Les industries grandes consommatrices d’eau, notamment les producteurs de boissons et d’aliments, prennent des mesures visant à améliorer leur efficacité, et ainsi à réduire leurs coûts, dans un contexte où la sécurité d’approvisionnement semble de moins en moins garantie.
Si la plupart de l’Europe n’a pas encore à s’en faire, les données indiquent que certaines parties de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la Belgique, des États baltes et de Chypre ont connu des crises d’approvisionnement en eau potable, avec une demande excédant l’offre.
___
>PROCHAINES ETAPES
- 2019 : Révision de la directive-cadre sur l’eau.
Plus d’information
Commission européenne
- Directive-cadre sur l’eau
- Plan de sauvegarde des eaux européennes (en anglais)
Agence internationale de l’énergie
- Perspectives énergétiques mondiales 2016 (en anglais)
- Lien entre eau et énergie (en anglais)
ONU
- Eau et énergie
___
Par Frédéric Simon, EurActiv.com (traduit par Manon Flausch)
(Article publié le mercredi 1 févr. 2017 + mis à jour le 1 févr. 2017)
___
>> Retrouvez toutes les actualités et débats qui animent l’Union Européenne sur Euractiv.fr